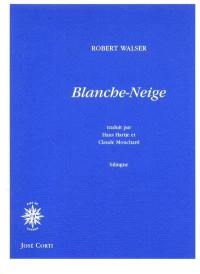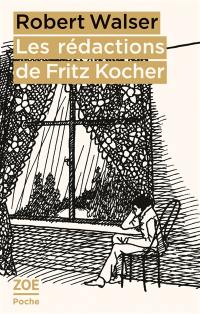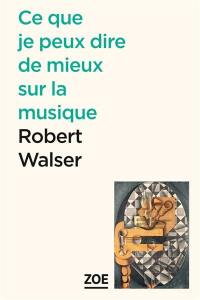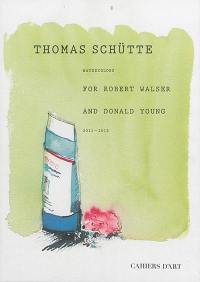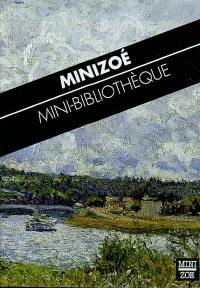Fiche technique
Format : Broché
Nb de pages : 238 pages
Poids : 238 g
Dimensions : 13cm X 19cm
EAN : 9782070243693
L'Institut Benjamenta (Jakob von Gunten)
Les libraires en parlent
Si l'on connait mieux le suisse de langue allemande Robert Walser (1878-1956) pour ses recueils de proses, on oublie souvent qu'il écrivit trois romans : Les enfants Tanner (Geschwister Tanner) en 1907, Le commis (Der Gehülfe) en 1908 et L'Institut Benjamenta (Jakob von Gunten) en 1909. Trois années, trois romans. En parallèle, et ce depuis 1898, il continue de publier ses textes courts jusqu'en 1925 où paraît son dernier recueil, La rose (Die Rose). S'en suit pour Walser une série implacable d'événements, la dernière étape d'un processus d'échec et de dispersion, de fragmentation de son identité. En 1929, à la suite d'un effondrement psychique, il est admis à la clinique psychiatrique de la Waldau à Berne. En 1933, il cesse d'écrire définitivement et est transféré à la clinique de Herisau. En 1956, le jour de Noël, il quitte le centre hospitalier et marche dans le neige jusqu'à mourir d'épuisement.
Admiré de son vivant par Walter Benjamin, Herman Hesse, Robert Musil ou encore Franz Kafka, Walser n'aura de cesse d'aspirer à l'anonymat et au silence. Son humilité obsessionnelle le pousse à une vie vagabonde faite d'emplois alimentaires mal payés (employé aux écritures, domestique, homme à tout faire) et de déménagements fréquents. Régulièrement, il démissionne pour se consacrer à la poésie et à ses proses. Ses économies épuisées, il offre indifféremment ses services aux patrons qui veulent bien de lui. Son attirance sans borne pour une existence obscure et humble lui rend insupportable la société intellectuelle allemande. Les textes qu'il publie dans les journaux de l'époque déroutent par leur fausse simplicité, par un caractère à la fois léger et profond, enfantin et grave, banal et en même temps condensé, prétendument anecdotique quand ils sont au contraire la trace d'une puissante inquiétude ontologique («J'ai commencé très tôt, dit un des personnage de Walser, à tirer de tout un sentiment de profondeur, même des sottises»). Son écriture interroge les directeurs de journaux et de revues, qui parfois ne publient Walser que sur l'insistance d'un ami. Certains moquent son allemand dépouillé, d'autres prétendent que ses proses sont comme rédigées par un enfant.
Sur la psychologie de Robert Walser, la préface de sa traductrice française Marthe Robert (également traductrice et spécialiste de Kafka) est éminemment éclairante. Rapprochant la poursuite de l'effacement et la mélancolie de Walser à celle du poète Heinrich von Kleist (son Michel Kohlaass passe pour avoir été le livre préféré de Kafka), Marthe Robert cite le témoignage d'un ami de Walser, Carl Seelig, sur le désir de disparition et le refus d'avoir une existence publique de l'écrivain suisse : «Jamais je n’oublierai ce matin d’automne où nous allions à pied de Teufen à Speicher, à travers une brume épaisse comme de l’ouate. Je lui dis ce jour-là que son œuvre littéraire durerait peut-être autant que celle de Gottfried Keller. Il s’arrêta, comme enraciné dans le sol, me regarda de l’air le plus grave et me dit que si je tenais à notre amitié, je ne vienne plus jamais lui faire de pareils compliments. Lui, Robert Walser, était un zéro et voulait être oublié.»
De Walser à Kleist en passant par Kafka, on comprend mieux ce qui lie ces auteurs : un certain caractère intempestif, déplacé, ambivalent et, pour nombre de leur contemporains, largement inexplicable. On pourrait également rajouter, dans une modalité certes différente mais proche, Fernando Pessoa pour la langue portugaise. Qu'est-ce qui a donc motivé Robert Walser à se lancer dans la rédaction de romans, lui qui n'aimait rien tant que l'esthétique du fragmentaire et de l'inachevé, et qui trouvait le genre romanesque inapproprié à sa nature ? : «À cette époque, j'étais possédé de l'envie d'écrire des romans. Mais je m'aperçus que je m'entêtais dans une forme beaucoup trop vaste pour mon talent. En conséquence, je me retirai dans la coquille du récit court et de feuilleton»
Quoi qu'il en soit, l'Institut Benjamenta est un roman important, digne d'attention à plus d'un titre. L'histoire est simple. Jacob von Gunten, enfant de bonne famille, a coupé tout lien avec ses proches. Décidé à trouver un jour une place de serviteur, il intègre une école de domestique qui d'emblée se trouve être une escroquerie, l'Institut Benjamenta. Ancêtre en bien des manières de certains de nos actuels centres privés de formation, l'Institut est une usine à gaz où l’on apprend « très peu », en fait absolument rien, sinon à obéir, à servir et à se rabaisser devant le sacro-saint règlement. La pédagogie est inexistante. Les professeurs absents. Les élèves s'ennuient docilement, font preuve d'une inertie totale. Ce décervelage qu'orchestrent le frère et la soeur Benjamenta, directeurs de l'Institut, n'est pas même volontaire. Il est seulement la conséquence du principe selon lequel il n'est besoin dans la vie que d'abdiquer sa conscience sur l'autel de la rectitude et de la loi. L'apparence du laquais prime sur sa pensée. «Et en tout, c'est la manière qui compte»
L'échec, chez Walser, s'accepte comme un sacerdoce, une «soumission volontaire à la rigueur et à l'affliction». L'échec est chez lui l'occasion «d'une angoisse indiciblement tendre». Il n'est jamais suffisant, il en faut toujours plus : «Qu'on me jette nu dans une rue glaciale, et peut-être m'imaginerai-je être le bon Dieu tout puissant». Disparaître à soi et aux autres est vital pour le personnage walsérien : « Il faut être une nullité, car rien n'est plus nuisible que de représenter prématurément quelque chose. » Par conséquent, on ne saurait être ambitieux sans se trahir.
Ainsi, ni Walser ni ses personnages ne sont dupes de l'avenir qui leur est promis : «Avec des sentiments comme ceux que j'éprouve à l'égard du monde, on n'obtient jamais rien de grand (...) Et si je me brise et me perds, qu'est-ce qui sera brisé et perdu ? Un zéro»
Tout un programme.
Quatrième de couverture
«Nous apprenons très peu ici, on manque de personnel enseignant, et nous autres, garçons de l'Institut Benjamenta, nous n'arriverons à rien, c'est-à-dire que nous serons plus tard des gens très humbles et subalternes.» Dès la première phrase, le ton est donné.
Jacob von Gunten a quitté sa famille pour entrer de son plein gré dans ce pensionnat où l'on n'apprend qu'une chose : obéir sans discuter. C'est une discipline du corps et de l'âme qui lui procure de curieux plaisirs : être réduit à zéro tout en enfreignant le sacro-saint règlement.
Jacob décrit ses condisciples, sort en ville, observe le directeur autoritaire, brutal, et sa sœur Lise, la douceur même. Tout ce qu'il voit nourrit ses réflexions et ses rêveries, tandis que l'Institut Benjamenta perd lentement les qualités qui faisaient son renom et s'achemine vers le drame.
«L'expérience réelle et la fantasmagorie sont ici dans un rapport poétique qui fait invinciblement penser à Kafka, dont on peut dire qu'il n'eût pas été tout à fait lui-même si Walser ne l'eût précédé», écrit Marthe Robert dans sa très belle préface où elle range l'écrivain, à juste titre, parmi les plus grands.